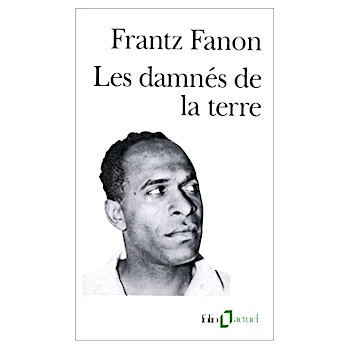
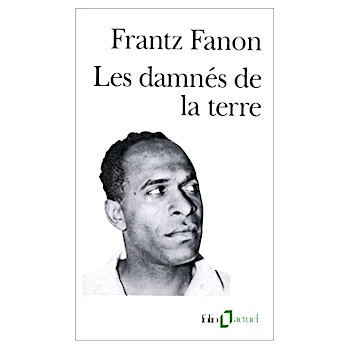
Ed. François Maspéro. Paris. 1961.
Préface de Jean-Paul Sartre
Les réflexions sur la violence nous ont amené à prendre conscience de l'existence fréquente d'un décalage, d'une différence de rythme entre les cadres du parti nationaliste et les masses. Dans toute organisation politique ou syndicale il existe classiquement un fossé entre les masses qui exigent l'amélioration immédiate et totale de leur situation et les cadres qui, mesurant les difficultés susceptibles d'être créées par le patronat, limitent et restreignent leurs revendications. C'est pourquoi on constate souvent un mécontentement tenace des masses vis-à-vis des cadres. Après chaque journée de revendication, alors que les cadres célèbrent la victoire, les masses ont bel et bien l'impression d'avoir été trahies. C'est la multiplication des manifestations revendicatives, la multiplication des conflits syndicaux qui provoqueront la politisation de ces masses. Un syndicaliste politisé étant celui qui sait qu'un conflit local n'est pas une explication décisive entre lui et le patronat. Les intellectuels colonisés qui ont étudié dans leurs métropoles respectives le fonctionnement des partis politiques mettent en place de semblables formations afin de mobiliser les masses et de faire pression sur l'administration coloniale. La naissance de partis nationalistes dans les pays colonisés est contemporaine de la constitution d'une élite intellectuelle et commerçante. Les élites vont attacher une importance fondamentale à l'organisation en tant que telle et le fétichisme de l'organisation prendra souvent le pas sur l'étude rationnelle de la société coloniale. La notion de parti est une notion importée de la métropole. Cet instrument des luttes modernes est plaqué tel quel sur une réalité protéiforme, [108] déséquilibrée, où coexistent à la fois l'esclavagisme, le servage, le troc, l'artisanat et les opérations boursières.
***
La faiblesse des partis politiques ne réside pas seulement dans l'utilisation mécanique d'une organisation qui conduit la lutte du prolétariat au sein d'une société capitaliste hautement industrialisée. Sur le plan limité du type d'organisation, des innovations, des adaptations auraient dû voir le jour. La grande erreur, le vice congénital de la majorité des partis politiques dans les régions sous-développées a été, selon le schéma classique, de s'adresser en priorité aux éléments les plus conscients : le prolétariat des villes, les artisans et les fonctionnaires, c'est-à-dire une infime partie de la population qui ne représente guère plus de un pour cent.
Or si ce prolétariat comprenait la propagande du parti et lisait sa littérature il était beaucoup moins préparé à répondre aux éventuels mots d'ordre de lutte implacable pour la libération nationale. On l'a maintes fois signalé : dans les territoires coloniaux, le prolétariat est le noyau du peuple colonisé le plus choyé par le régime colonial. Le prolétariat embryonnaire des villes est relativement privilégié. Dans les pays capitalistes, le prolétariat n'a rien à perdre, il est celui qui, éventuellement, aurait tout à gagner. Dans les pays colonisés le prolétariat a tout à perdre. Il représente en effet la fraction du peuple colonisé nécessaire et irremplaçable pour la bonne marche de la machine coloniale : conducteurs de tramways, de taxis, mineurs, dockers, interprètes, infirmiers, etc. Ce sont ces éléments qui constituent la clientèle la plus fidèle des partis nationalistes et qui par la place privilégiée qu'ils occupent dans le système colonial constituent la fraction « bourgeoise » du peuple colonisé.
Aussi comprend-on que la clientèle des partis politiques nationalistes soit avant tout urbaine : agents de maîtrise, ouvriers, intellectuels et commerçants résidant essentiellement dans les villes. Leur type de pensée porte déjà en de nombreux points la marque du milieu technique et relativement aisé dans lequel ils évoluent. Ici le « modernisme » est roi. Ce sont ces [109] mêmes milieux qui vont lutter contre les traditions obscurantistes, qui vont réformer les coutumes, entrant ainsi en lutte ouverte contre le vieux socle de granit qui constitue le fonds national.
***
Les partis nationalistes, dans leur immense majorité, éprouvent une grande méfiance à l'égard des masses rurales. Ces masses leur donnent en effet l'impression de s'enliser dans l'inertie et dans l'infécondité. Assez rapidement les membres des partis nationalistes (ouvriers des villes et intellectuels) en arrivent à porter sur les campagnes le même jugement péjoratif que les colons. Mais si l'on tâche de comprendre les raisons de cette méfiance des partis politiques envers les masses rurales il faut retenir le fait que le colonialisme a souvent renforcé ou assis sa domination en organisant la pétrification des campagnes. Encadrées par les marabouts, les sorciers et les chefs coutumiers, les masses rurales vivent encore au stade féodal, la toute-puissance de cette structure moyenâgeuse étant alimentée par les agents administratifs ou militaires colonialistes.
La jeune bourgeoisie nationale, commerçante surtout, va entrer en compétition avec ces seigneurs féodaux dans des secteurs multiples : marabouts et sorciers qui barrent la route aux malades qui pourraient consulter le médecin, djemaas qui jugent, rendant inutiles les avocats, caïds qui utilisent leur puissance politique et administrative pour lancer un commerce ou une ligne de transports, chefs coutumiers s'opposant au nom de la religion et de la tradition à l'introduction de négoces et de produits nouveaux.
La jeune classe de commerçants et de négociants colonisés a besoin de la disparition de ces prohibitions et de ces barrières pour se développer. La clientèle indigène qui représente la chasse gardée des féodaux et qui se voit plus ou moins interdire l'achat de produits nouveaux constitue donc un marché que l'on se dispute.
Les cadres féodaux forment un écran entre les jeunes nationalistes occidentalisés et les masses. Chaque fois que les élites [110] font un effort en direction des masses rurales, les chefs de tribus, les chefs de confréries, les autorités traditionnelles multiplient les mises en garde, les menaces, les excommunications. Ces autorités traditionnelles qui ont été confirmées par la puissance occupante voient sans plaisir se développer les tentatives d'infiltration des élites dans les campagnes. Elles savent que les idées susceptibles d'être introduites par ces éléments venus des villes contestent le principe même de la pérennité des féodalités. Aussi leur ennemi n'est-il point la puissance occupante avec laquelle elles font, somme toute, bon ménage mais ces modernistes qui entendent désarticuler la société autochtone et par là même leur enlever le pain de la bouche.
Les éléments occidentalisés éprouvent à l'égard des masses paysannes des sentiments qui rappellent ceux que l'on trouve au sein du prolétariat des pays industrialisés. L'histoire des révolutions bourgeoises et l'histoire des révolutions prolétariennes ont montré que les masses paysannes constituent souvent un frein à la révolution. Les masses paysannes dans les pays industrialisés sont généralement les éléments les moins conscients, les moins organisés et aussi les plus anarchistes. Elles présentent tout un ensemble de traits, individualisme, indiscipline, amour du gain, aptitude aux grandes colères et aux profonds découragements, définissant un comportement objectivement réactionnaire.
***
Nous avons vu que les partis nationalistes calquent leurs méthodes et leurs doctrines sur les partis occidentaux, aussi, dans la majorité des cas, n'orientent-ils leur propagande en direction de ces masses. En réalité l'analyse rationnelle de la société colonisée, si elle avait été pratiquée, leur aurait montré que les paysans colonisés vivent dans un milieu traditionnel dont les structures sont demeurées intactes, alors que dans les pays industrialisés c'est ce milieu traditionnel qui a été lézardé par les progrès de l'industrialisation. C'est au sein du prolétariat embryonnaire qu'on trouve aux colonies des comportements individualistes. En abandonnant les campagnes où la démographie pose des problèmes insolubles, les paysans sans terre, qui [111] constituent le lumpen-prolétariat, se ruent vers les villes, s'entassent dans les bidonvilles et tâchent de s'infiltrer dans les ports et les cités nés de la domination coloniale. Les masses paysannes, elles, continuent de vivre dans un cadre immobile et les bouches en surnombre n'ont d'autre ressource que d'émigrer vers les cités. Le paysan qui reste sur place défend avec ténacité ses traditions et, dans la société colonisée, représente l'élément discipliné dont la structure sociale demeure communautaire. Il est vrai que cette vie immobile, crispée sur des cadres rigides, peut donner naissance épisodiquement à des mouvements à base de fanatisme religieux, à des guerres tribales. Mais dans leur spontanéité les masses rurales demeurent disciplinées, altruistes. L'individu s'efface devant la communauté.
Les paysans ont une méfiance à l'égard de l'homme de la ville. Habillé comme l'Européen, parlant sa langue, travaillant avec lui, habitant parfois dans son quartier, il est considéré par les paysans comme un transfuge qui a abandonné tout ce qui constitue le patrimoine national. Les gens des villes sont « des traîtres, des vendus » qui semblent faire bon ménage avec l'occupant et s'efforcent dans le cadre du système colonial de réussir. C'est pourquoi on entend souvent dire par les paysans que les gens des villes sont sans moralité. Nous ne nous trouvons pas ici en présence de la classique opposition de la campagne et de la ville. C'est l'opposition entre le colonisé exclu des avantages du colonialisme et celui qui s'arrange pour tirer parti de l'exploitation coloniale.
Les colonialistes utilisent d'ailleurs cette opposition dans leur lutte contre les partis nationalistes. Ils mobilisent les montagnards, les blédards contre les gens de la ville. Ils dressent l'arrière-pays contre les côtes, ils réactivent les tribus et il ne faut pas s'étonner de voir Kalondji se faire couronner roi du Kasaï, comme il ne fallait pas s'étonner il y a quelques années de voir l'Assemblée des chefs du Ghana tenir la dragée haute à N'Krumah.
Les partis politiques n'arrivent pas à implanter leur organisation dans les campagnes. Au lieu d'utiliser les structures existantes [112] pour leur donner un contenu nationaliste ou progressiste ils entendent, dans le cadre du système colonial, bouleverser la réalité traditionnelle. Ils s'imaginent pouvoir faire démarrer la nation alors que les mailles du système colonial sont encore pesantes. Ils ne vont pas à la rencontre des masses. Ils ne mettent pas leurs connaissances théoriques au service du peuple mais ils tentent d'encadrer les masses selon un schéma a priori. Aussi, de la capitale, vont-ils parachuter dans les villages des dirigeants inconnus ou trop jeunes qui, investis par l'autorité centrale, entendent mener le douar ou le village comme une cellule d'entreprise. Les chefs traditionnels sont ignorés, quelquefois brimés. L'histoire de la nation future piétine avec une singulière désinvolture les petites histoires locales, c'est-à-dire la seule actualité nationale alors qu'il faudrait insérer harmonieusement l'histoire du village, l'histoire des conflits traditionnels des clans et des tribus dans l'action décisive à laquelle on appelle le peuple. Les vieux, entourés de respect dans les sociétés traditionnelles et généralement revêtus d'une autorité morale indiscutable, sont publiquement ridiculisés. Les services de l'occupant ne se font pas faute d'utiliser ces rancunes et se tiennent au courant des moindres décisions adoptées par cette caricature d'autorité. La répression policière, éclairée parce que basée sur des renseignements précis, s'abat. Les dirigeants parachutés et les membres importants de la nouvelle assemblée sont arrêtés.
Les échecs subis confirment « l'analyse théorique » des partis nationalistes. L'expérience désastreuse de tentative d'embrigadement des masses rurales renforce leur méfiance et cristallise leur agressivité contre cette partie du peuple. Après le triomphe de la lutte de libération nationale, les mêmes erreurs se renouvellent, alimentant les tendances décentralisatrices et autonomistes. Le tribalisme de la phase coloniale fait place au régionalisme de la phase nationale, avec son expression institutionnelle : le fédéralisme.
Mais il se trouve que les masses rurales, malgré le peu d'emprise que les partis nationalistes ont sur elles, interviennent de [113] maniè-re décisive soit dans le processus de maturation de la conscience na-tionale, soit pour relayer l'action des partis nationalistes, soit plus ra-rement pour se substituer purement et simplement à la stérilité de ces partis. La propagande des partis nationalistes trouve toujours un écho au sein des masses paysannes. Le souvenir de la période anticoloniale de-meure vivace dans les villages. Les femmes murmurent encore à l'oreille des enfants les chants qui ont accompagné les guerriers résis-tant à la conquête. À 12, 13 ans les petits villageois connaissent le nom des vieillards qui ont assisté à la dernière insurrection et les rêves dans les douars, dans les villages ne sont pas les rêves de luxe ou de succès aux examens que font les enfants des villes, mais des rêves d'identification à tel ou tel combattant dont le récit de la mort héroï-que provoque encore aujourd'hui d'abondantes larmes.
***
Au moment où les partis nationalistes tentent d'organiser la classe ouvrière embryonnaire des villes, on assiste dans les campagnes à des explosions en apparence absolument inexplicables. C'est par exemple la fameuse insurrection de 1947 à Madagascar. Les services colonialistes sont formels : c'est une jacquerie. En fait nous savons aujourd'hui que les choses, comme toujours, furent beaucoup plus compliquées. Au cours de la Seconde Guerre mondiale les grandes compagnies coloniales étendirent leur puissance et s'emparèrent de la totalité des terres encore libres. Toujours à cette même époque on parla de l'implantation éventuelle dans l'île de réfugiés juifs, kabyles, antillais. La rumeur courut également de l'invasion prochaine de l'île avec la complicité des colons par les Blancs d'Afrique du Sud. Aussi, après la guerre, les candidats de la liste nationaliste furent-ils triomphalement élus. Immédiatement après, la répression s'organisa contre les cellules du parti MDRM (Mouvement démocratique de la rénovation malgache). Le colonialisme, pour parvenir à ses fins, utilisa les moyens les plus classiques : arrestations multiples, propagande raciste intertribale et création d'un parti avec les éléments inorganisés du lumpen-prolétariat. [114] Ce parti dit des Déshérités de Madagascar (PADESM) apportera à l'autorité coloniale, par ses provocations décisives, la caution légale du maintien de l'ordre. Or cette opération banale de liquidation d'un parti préparée à l'avance prend ici des proportions gigantesques. Les masses rurales, sur la défensive depuis trois ou quatre ans, se sentent soudain en danger de mort et décident de s'opposer farouchement aux forces colonialistes. Armé de sagaies et plus souvent de pierres et de bâtons, le peuple se jette dans l'insurrection généralisée en vue de la libération nationale. On connaît la suite.
Ces insurrections armées ne représentent qu'un des moyens utilisés par les masses rurales pour intervenir dans la lutte nationale. Quelquefois les paysans prennent le relais de l'agitation urbaine, le parti nationaliste dans les villes étant l'objet de la répression policière. Les nouvelles parviennent aux campagnes amplifiées, démesurément amplifiées : leaders arrêtés, mitraillages multiples, le sang nègre inonde la ville, les petits colons se baignent dans le sang arabe. Alors la haine accumulée, la haine exacerbée éclate. Le poste de police avoisinant est investi, les gendarmes sont déchiquetés, l'instituteur est massacré, le médecin n'a la vie sauve que parce qu'il était absent, etc. Des colonnes de pacification sont dépêchées sur les lieux, l'aviation bombarde. L'étendard de la révolte est alors déployé, les vieilles traditions guerrières resurgissent, les femmes applaudissent, les hommes s'organisent et prennent position dans les montagnes, la guérilla commence. Spontanément les paysans créent l'insécurité généralisée, le colonialisme prend peur, s'installe dans la guerre ou négocie.
Comment réagissent les partis nationalistes à cette irruption décisive des masses paysannes dans la lutte nationale ? Nous avons vu que la majorité des partis nationalistes n'ont pas inscrit dans leur propagande la nécessité de l'action armée. Ils ne s'opposent pas à la persistance de l'insurrection, mais ils se contentent de faire confiance à la spontanéité des ruraux. En [115] gros, ils se comportent à l'égard de cet élément nouveau comme s'il s'agissait d'une manne tombée du ciel, priant le sort que ça continue. Ils exploitent cette manne mais ne tentent pas d'organiser l'insurrection. Ils n'envoient pas dans les campagnes des cadres pour politiser les masses, pour éclairer les consciences, pour élever le niveau du combat. Ils espèrent qu'emportée par son mouvement l'action de ces masses ne se ralentira pas. Il n'y a pas contamination du mouvement rural par le mouvement urbain. Chacun évolue selon sa dialectique propre.
Les partis nationalistes ne tentent pas d'introduire dans les masses rurales, qui sont à ce moment entièrement disponibles, des mots d'ordre. Ils ne leur proposent pas d'objectif, ils espèrent simplement que ce mouvement se perpétuera indéfiniment et que les bombardements n'en viendront pas à bout. On voit donc que, même à cette occasion, les partis nationalistes n'exploitent pas la possibilité qui leur est offerte d'intégrer les masses rurales, de les politiser, d'élever le niveau de leur lutte. On maintient la position criminelle de méfiance vis-à-vis des campagnes.
Les cadres politiques se terrent dans les villes, font comprendre au colonialisme qu'ils n'ont pas de rapport avec les insurgés ou partent à l'étranger. Il arrive rarement qu'ils rejoignent le peuple dans les montagnes. Au Kenya, par exemple, pendant l'insurrection Mau-Mau aucun nationaliste connu n'a revendiqué son appartenance à ce mouvement ou tenté de défendre ces hommes.
Il n'y a pas d'explication féconde, pas de confrontation entre les différentes couches de la nation. Aussi, au moment de l'indépendance, survenue après la répression exercée sur les masses rurales et l'entente entre le colonialisme et les partis nationalistes, retrouvons-nous accentuée cette incompréhension. Les ruraux se montreront réticents à l'égard des réformes de structure proposées par le gouvernement ainsi que des innovations sociales, même objectivement progressistes, parce que précisément les responsables actuels du régime n'ont pas expliqué à l'ensemble du peuple, pendant la période coloniale, les objectifs [116] du parti, l'orientation nationale, les problèmes internationaux, etc.
***
À la méfiance que les ruraux et les féodaux entretenaient à l'égard des partis nationalistes pendant la période coloniale fait suite une hostilité égale pendant la période nationale. Les services secrets colonialistes, qui n'ont pas désarmé après l'indépendance, entretiennent le mécontentement et arrivent encore à créer aux jeunes gouvernements de graves difficultés. Somme toute, le gouvernement ne fait que payer sa paresse de la période de libération et son constant mépris des ruraux. La nation pourra avoir une tête raisonnable, progressiste même, mais le corps immense restera débile, rétif, non coopératif. La tentation sera alors de briser ce corps en centralisant l'administration et en encadrant fermement le peuple. C'est l'une des raisons pour lesquelles on entend souvent dire que, dans les pays sous-développés, il faut une certaine dose de dictature. Les dirigeants se méfient des masses rurales. C'est le cas par exemple de certains gouvernements qui, bien longtemps après l'indépendance nationale, considèrent l'arrière-pays comme une région non pacifiée où le chef de l'État, les ministres, ne s'aventurent qu'à l'occasion des manoeuvres de l'armée nationale. Cet arrière-pays est assimilé pratiquement à l'inconnu. Paradoxalement, le gouvernement national dans son comportement à l'égard des masses rurales rappelle par certains traits le pouvoir colonial. « On ne sait pas très bien comment ces masses vont réagir » et les jeunes dirigeants n'hésitent pas à dire : « Il faut la trique, si l'on veut sortir ce pays du Moyen Âge. » Mais, nous l'avons vu, la désinvolture avec laquelle les partis politiques ont agi avec les masses rurales pendant la phase coloniale ne pouvait qu'être préjudiciable à l'unité nationale, au démarrage accéléré de la nation.
***
Quelquefois le colonialisme tente de diversifier, de disloquer la poussée nationaliste. Au lieu de dresser les cheiks et les chefs contre les « révolutionnaires » des villes, les bureaux indigènes [117] organisent les tribus et les confréries en partis. Face au parti urbain qui commençait à « incarner la volonté nationale » et à constituer un danger pour le régime colonial, des groupuscules prennent naissance, des tendances, des partis à base ethnique ou régionaliste surgissent. C'est la tribu dans son intégralité qui se mue en parti politique conseillé de près par les colonialistes. La table ronde peut commencer. Le parti unitaire sera noyé dans l'arithmétique des tendances. Les partis tribaux s'opposent à la centralisation, à l'unité et dénoncent la dictature du parti unitaire. Plus tard, cette tactique sera utilisée par l'opposition nationale. Parmi les deux ou trois partis nationalistes qui ont mené la lutte de libération, l'occupant a fait son choix. Les modalités de ce choix sont classiques : lorsqu'un parti a fait l'unanimité nationale et s'est imposé à l'occupant comme seul interlocuteur, l'occupant multiplie les manoeuvres et retarde au maximum l'heure des négociations. Ce retard sera utilisé à émietter les exigences de ce parti ou à obtenir de la direction la mise à l'écart de certains éléments « extrémistes ».
***
Si, par contre, aucun parti ne s'est véritablement imposé, l'occupant se contente de privilégier celui qui lui paraît le plus « raisonnable ». Les partis nationalistes qui n'ont pas participé aux négociations se lancent alors dans une dénonciation de l'accord intervenu entre l'autre parti et l'occupant. Le parti qui reçoit le pouvoir de l'occupant, conscient du danger que constituent les positions strictement démagogiques et confuses du parti rival, tente de le démanteler et le condamne à l'illégalité. Le parti persécuté n'a d'autre ressource que de se réfugier à la périphérie des villes et dans les campagnes. Il essaie de soulever les masses rurales contre les « vendus de la côte et les corrompus de la capitale ». Tous les prétextes sont alors utilisés : arguments religieux, dispositions novatrices prises par la nouvelle autorité nationale et qui rompent avec la tradition. On exploite la tendance obscurantiste des masses rurales. La doctrine dite révolutionnaire repose en fait sur le caractère rétrograde, passionnel [118] et spontanéiste des campagnes. On murmure çà et là que la montagne bouge, que les campagnes sont mécontentes. On affirme que dans tel coin la gendarmerie a ouvert le feu sur des paysans, que des renforts ont été envoyés, que le régime est près de s'écrouler. Les partis d'opposition, sans programme clair, n'ayant d'autre but que de se substituer à l'équipe dirigeante, remettent leur destin entre les mains spontanées et obscures des masses paysannes. Inversement, il arrive que l'opposition ne s'appuie plus sur les masses rurales mais sur les éléments progressistes, les syndicats de la jeune nation. Dans ce cas, le gouvernement fait appel aux masses pour résister aux revendications des travailleurs, dénoncées alors comme manoeuvres d'aventuriers antitraditionalistes. Les constatations que nous avons eu l'occasion de faire au niveau des partis politiques se retrouvent, mutatis mutandis, au niveau des syndicats. Au début, les formations syndicales dans les territoires coloniaux sont régulièrement des branches locales des syndicats métropolitains et les mots d'ordre répondent en écho à ceux de la métropole.
***
La phase décisive de la lutte de libération se précisant, quelques syndicalistes indigènes vont décider la création de syndicats nationaux. L'ancienne formation, importée de la métropole, sera massivement désertée par les autochtones. Cette création syndicale est un nouvel élément de pression pour les populations urbaines sur le colonialisme. Nous avons dit que le prolétariat aux colonies est embryonnaire et représente la fraction du peuple la plus favorisée. Les syndicats nationaux nés dans la lutte s'organisent dans les villes et leur programme est avant tout un, programme politique, un programme nationaliste. Mais ce syndicat national né au cours de la phase décisive du combat pour l'indépendance est en fait l'enrégimentement légal des éléments nationalistes conscients et dynamiques.
Les masses rurales, dédaignées par les partis politiques, continuent à être tenues à l'écart. Il y aura, bien sûr, un syndicat des travailleurs agricoles mais cette création se contente de [119] répondre à la nécessité formelle de « présenter un front uni au colonialisme ». Les responsables syndicaux qui ont fait leurs armes dans le cadre des formations syndicales métropolitaines ne savent pas organiser les masses urbaines. Ils ont perdu tout contact avec la paysannerie et se préoccupent en premier lieu de l'embrigadement des métallos, des dockers, des fonctionnaires du gaz et de l'électricité, etc.
Pendant la phase coloniale, les formations syndicales nationalistes constituent une force de frappe spectaculaire. Dans les villes, les syndicats peuvent immobiliser, en tout cas enrayer à n'importe quel moment, l'économie colonialiste. Comme le peuplement européen est souvent cantonné dans les villes, les répercussions psychologiques des manifestations sur ce peuplement sont considérables : pas d'électricité, pas de gaz, les ordures ne sont pas ramassées, les marchandises pourrissent sur les quais.
Ces îlots métropolitains que constituent les villes dans le cadre colonial ressentent profondément l'action syndicale. La forteresse du colonialisme représentée par la capitale, supporte difficilement ces coups de boutoir. Mais « l'intérieur » (les masses rurales) demeure étranger à cette confrontation.
Ainsi, on le voit, il y a une disproportion du point de vue national entre l'importance des syndicats et le reste de la nation. Après l'indépendance, les ouvriers embrigadés dans les syndicats ont l'impression de tourner à vide. L'objectif limité qu'ils s'étaient fixé se révèle, au moment même où il est atteint, bien précaire eu égard à l'immensité de la tâche de construction nationale. Face à la bourgeoisie nationale dont les relations avec le pouvoir sont souvent très étroites, les dirigeants syndicaux découvrent qu'ils ne peuvent plus se cantonner dans l'agitation ouvriériste.
Congénitalement isolés des masses rurales, incapables de diffuser des mots d'ordre au-delà des faubourgs, les syndicats adoptent des positions de plus en plus politiques. En fait, les syndicats sont candidats au pouvoir. Ils tentent par tous les moyens d'acculer la bourgeoisie : protestation contre le maintien des bases étrangères sur le territoire national, dénonciation [120] des accords commerciaux, prises de position contre la politique extérieure du gouvernement national. Les ouvriers maintenant « indépendants » tournent à vide. Les syndicats s'aperçoivent au lendemain de l'indépendance que les revendications sociales si elles étaient exprimées scandaliseraient le reste de la nation. Les ouvriers sont en effet les favorisés du régime. Ils représentent la fraction la plus aisée du peuple. Une agitation qui se proposerait d'arracher l'amélioration des conditions de vie pour les ouvriers et les dockers serait non seulement impopulaire, mais risquerait encore de provoquer l'hostilité des masses déshéritées des campagnes. Les syndicats, à qui tout syndicalisme est interdit, piétinent sur place.
Ce malaise traduit la nécessité objective d'un programme social intéressant enfin l'ensemble de la nation. Les syndicats découvrent subitement que l'arrière-pays doit être également éclairé et organisé. Mais, parce qu'à aucun moment ils ne se sont préoccupés de mettre en place des courroies de transmission entre eux et les masses paysannes, et comme précisément ces masses constituent les seules forces spontanément révolutionnaires du pays, les syndicats vont faire la preuve de leur inefficacité et découvrir le caractère anachronique de leur programme.
Les dirigeants syndicaux, plongés dans l'agitation politico-ouvriériste, en arrivent mécaniquement à la préparation d'un coup d'État. Mais, là encore, l'intérieur est exclu. C'est une explication limitée entre la bourgeoisie nationale et l'ouvriérisme syndical. La bourgeoisie nationale, reprenant les vieilles traditions du colonialisme, montre ses forces militaires et policières, tandis que les syndicats organisent des meetings, mobilisent des dizaines de milliers d'adhérents. Les paysans, face à cette bourgeoisie nationale et à ces ouvriers qui, somme toute, mangent à leur faim, regardent en haussant les épaules. Les paysans haussent les épaules, car ils se rendent compte que les uns et les autres les considèrent comme une force d'appoint. Les syndicats, les partis ou le gouvernement, dans une sorte de machiavélisme immoral, utilisent les masses paysannes comme force de manoeuvre inerte, aveugle. Comme force brute.
Dans certaines circonstances par contre, les masses paysannes vont intervenir de façon décisive, à la fois dans la lutte de libération nationale et dans les perspectives que se choisit la nation future. Ce phénomène revêt pour les pays sous-développés une importance fondamentale ; c'est pourquoi nous nous proposons de l'étudier en détail.
Nous avons vu que, dans les partis nationalistes, la volonté de briser le colonialisme fait bon ménage avec une autre volonté : celle de s'entendre à l'amiable avec lui. Au sein de ces partis, deux processus vont quelquefois se produire. D'abord, des éléments intellectuels ayant procédé à une analyse soutenue de la réalité coloniale et de la situation internationale commenceront à critiquer le vide idéologique du parti national et son indigence tactique et stratégique. Ils se mettent à poser inlassablement aux dirigeants, des questions cruciales : « Qu'est-ce que le nationalisme ? Que mettez-vous derrière ce mot ? Que contient ce vocable ?
L'indépendance pour quoi ? Et d'abord comment pensez-vous y parvenir ? » tout en exigeant que les problèmes méthodologiques soient abordés avec vigueur. Aux moyens électoralistes, ils vont suggérer d'adjoindre « tout autre moyen ». Aux premières escarmouches, les dirigeants se débarrassent vite de ce bouillonnement qu'ils qualifient volontiers de juvénile. Mais, parce que ces revendications ne sont ni l'expression d'un bouillonnement, ni la marque de la jeunesse les éléments révolutionnaires qui défendent ces positions vont être rapidement isolés. Les dirigeants drapés dans leur expérience vont rejeter impitoyablement « ces aventuriers, ces anarchistes ».
La machine du parti se montre rebelle à toute innovation. La minorité révolutionnaire se retrouve seule, face à une direction apeurée et angoissée à l'idée qu'elle pourrait être emportée dans une tourmente dont elle n'imagine même pas les aspects, la force ou l'orientation. Le deuxième processus a trait aux cadres dirigeants ou subalternes qui, du fait de leurs activités, ont été en butte aux persécutions policières colonialistes. Ce qu'il est intéressant de signaler, c'est que ces hommes sont arrivés aux [122] sphères dirigeantes du parti par leur travail obstiné, l'esprit de sacrifice et un patriotisme exemplaire. Ces hommes, venus de la base, sont souvent de petits manoeuvres, des travailleurs saisonniers et même quelquefois d'authentiques chômeurs. Pour eux, militer dans un parti national, ce n'est pas faire de la politique, c'est choisir le seul moyen de passer de l'état animal à l'état humain. Ces hommes, que gêne le légalisme exacerbé du parti, vont révéler dans les limites des activités qui leur sont confiées un esprit d'initiative, un courage et un sens de la lutte qui presque mécaniquement les désignent aux forces de répression du colonialisme. Arrêtés, condamnés, torturés, amnistiés, ils utilisent la période de détention à confronter leurs idées et à durcir leur détermination. Dans les grèves de la faim, dans la solidarité violente des fosses communes des prisons, ils vivent leur libération comme une occasion qui leur sera donnée de déclencher la lutte armée. Mais dans le même temps, au dehors, le colonialisme qui commence à être assailli de partout fait des avances aux modérés nationalistes.
***
On assiste donc à un écartèlement proche de la rupture entre la tendance illégaliste et la tendance légaliste du parti. Les illégaux se sentent indésirables. On les fuit. En prenant d'infinies précautions, les légaux du parti leur viennent en aide mais déjà ils se sentent étrangers. Ces hommes vont alors entrer en contact avec les éléments intellectuels dont ils avaient pu apprécier les positions quelques années auparavant. Un parti clandestin, latéral au parti légal, consacre cette rencontre. Mais la répression contre ces éléments irrécupérables s'intensifie à mesure que le parti légal se rapproche du colonialisme en tentant de le modifier « de l'intérieur ». L'équipe illégale se trouve alors dans un cul-de-sac historique.
Rejetés des villes, ces hommes se groupent, dans un premier temps, dans les banlieues périphériques. Mais le filet policier les y déniche et les contraint à quitter définitivement les villes, à fuir les lieux de la lutte politique. Ils se rejettent vers les campagnes, vers les montagnes, vers les masses paysannes. Dans un [123] premier temps, les masses se referment sur eux en les soustrayant à la recherche policière. Le militant nationaliste qui décide, au lieu de jouer à cache-cache avec les policiers dans les cités urbaines, de remettre son destin entre les mains des masses paysannes ne perd jamais. Le manteau paysan se referme sur lui avec une tendresse et une vigueur insoupçonnées. Véritables exilés de l'intérieur, coupés du milieu urbain au sein duquel ils avaient précisé les notions de nation et de lutte politique, ces hommes sont devenus en fait des maquisards. Obligés tout le temps de se déplacer pour échapper aux policiers, marchant la nuit pour ne pas attirer l'attention, ils vont avoir l'occasion de parcourir, de connaître leur pays. Oubliés les cafés, les discussions sur les prochaines élections, la méchanceté de tel policier. Leurs oreilles entendent la vraie voix du pays et leurs yeux voient la grande, l'infinie misère du peuple. Ils se rendent compte du temps précieux qui a été perdu en vains commentaires sur le régime colonial. Ils comprennent enfin que le changement ne sera pas une réforme, ne sera pas une amélioration. Ils comprennent, dans une sorte de vertige qui ne cessera plus de les habiter, que l'agitation politique dans les villes sera toujours impuissante à modifier, à bouleverser le régime colonial.
Ces hommes prennent l'habitude de parler aux paysans. Ils découvrent que les masses rurales n'ont jamais cessé de poser le problème de leur libération en termes de violence, de terre à reprendre aux étrangers, de lutte nationale, d'insurrection armée. Tout est simple. Ces hommes découvrent un peuple cohérent qui se perpétue dans une sorte d'immobilité mais qui garde intacts ses valeurs morales, son attachement à la nation. Ils découvrent un peuple généreux, prêt au sacrifice, désireux de se donner, impatient et d'une fierté de pierre. On comprend que la rencontre de ces militants traqués par la police et de ces masses piaffantes, et d'instinct rebelles puisse donner un mélange détonant d'une puissance inaccoutumée. Les hommes venus des villes se mettent à l'école du peuple et dans le même temps ouvrent, à l'intention du peuple, des cours de formation politique et militaire. Le peuple fourbit ses armes. En fait, les [124] cours ne durent pas longtemps car les masses, reprenant contact avec l'intimité même de leurs muscles, amènent les dirigeants à brusquer les choses. La lutte armée est déclenchée.
L'insurrection désoriente les partis politiques. Leur doctrine, en effet, a toujours affirmé l'inefficacité de toute épreuve de force et leur existence même est une constante condamnation de toute insurrection. Secrètement, certains partis politiques partagent l'optimisme des colons et se félicitent d'être en dehors de cette folie dont on dit qu'elle sera réprimée dans le sang. Mais le feu allumé, comme une épidémie galopante, se propage à l'ensemble du pays. Les blindés et les avions ne remportent pas les succès escomptés. Devant l'étendue du mal, le colonialisme commence à réfléchir. Au sein même du peuple qui opprime, des voix se font entendre qui attirent l'attention sur la gravité de la situation.
Le peuple quant à lui, dans ses huttes et dans ses rêves, se met en communication avec le nouveau rythme national. À voix basse, au milieu de son coeur, il chante aux glorieux combattants des hymnes interminables. L'insurrection a déjà envahi la nation. C'est au tour des partis d'être maintenant isolés.
Pourtant les dirigeants de l'insurrection prennent conscience, un jour ou l'autre, de la nécessité d'étendre cette insurrection aux villes. Cette prise de conscience n'est pas fortuite. Elle consacre la dialectique qui préside au développement d'une lutte armée de libération nationale. Quoique les campagnes représentent des réserves inépuisables d'énergie populaire et que les groupes armés y fassent régner l'insécurité, le colonialisme ne doute pas réellement de la solidité de son système. Il ne se sent pas fondamentalement en danger. Le dirigeant de l'insurrection décide donc de porter la guerre chez l'ennemi, c'est-à-dire dans les cités tranquilles et grandiloquentes.
L'installation de l'insurrection dans les cités pose à la direction des problèmes difficiles. On a vu que la plupart des dirigeants, nés ou ayant grandi dans les villes, avaient fui leur [125] milieu naturel, parce que pourchassés par la police colonialiste et généralement incompris des cadres prudents et raisonnables des partis politiques. Leur retraite dans les campagnes a été à la fois une fuite devant la répression et une méfiance à l'égard des vieilles formations politiques. Les antennes urbaines naturelles de ces dirigeants sont les nationalistes connus au sein des partis politiques. Mais, précisément, nous avons vu que leur histoire récente s'était déroulée latéralement à ces dirigeants timorés et crispés dans une réflexion ininterrompue sur les méfaits du colonialisme.
D'ailleurs, les premières tentatives que les hommes du maquis feront en direction de leurs anciens amis, ceux précisément qu'ils estiment être le plus à gauche, confirmeront leurs appréhensions et leur enlèveront jusqu'au désir même de revoir les vieilles connaissances. En fait l'insurrection, partie des campagnes, va pénétrer dans les villes par la fraction de la paysannerie bloquée à la périphérie urbaine, celle qui n'a pu encore trouver un os à ronger dans le système colonial. Les hommes que la population croissante des campagnes, l'expropriation coloniale ont amenés à déserter la terre familiale tournent inlassablement autour des différentes villes, espérant qu'un jour ou l'autre on leur permettra d'y entrer. C'est dans cette masse, c'est dans ce peuple des bidonvilles, au sein du lumpen-prolétariat que l'insurrection va trouver son fer de lance urbain. Le lumpen-prolétariat constitue l'une des forces le plus spontanément et le plus radicalement révolutionnaires d'un peuple colonisé.
***
Au Kenya, dans les années qui ont précédé la révolte des MauMau, on a vu les autorités coloniales britanniques multiplier les mesures d'intimidation contre le lumpen-prolétariat. Forces de police et missionnaires ont coordonné leurs efforts, dans les années 1950-1951, pour répondre comme il convenait à l'afflux énorme de jeunes Kenyans venus des campagnes et des forêts et qui, n'arrivant pas à se placer sur le marché, volaient, se livraient à la débauche, à l'alcoolisme, etc. La délinquance juvénile dans les pays colonisés est le produit direct de l'existence [126] du lumpen-prolétariat. Pareillement, au Congo, des mesures draconiennes furent prises à partir de 1957 pour refouler dans les campagnes les « jeunes voyous » qui perturbaient l'ordre établi. Des camps de recasement furent ouverts et confiés aux missions évangéliques sous la protection, bien sûr, de l'armée belge.
La constitution d'un lumpen-prolétariat est un phénomène qui obéit à une logique propre et ni l'activité débordante des missionnaires, ni les arrêtés du pouvoir central ne peuvent enrayer sa progression. Ce lumpen-prolétariat, pareil à une meute de rats, malgré les coups de pied, malgré les coups de pierres, continue à ronger les racines de l'arbre.
Le bidonville consacre la décision biologique du colonisé d'envahir coûte que coûte, et s'il le faut par les voies les plus souterraines, la citadelle ennemie. Le lumpen-prolétariat constitué et pesant de toutes ses forces sur la « sécurité » de la ville signifie le pourrissement irréversible, la gangrène installée au coeur de la domination coloniale. Alors les souteneurs, les voyous, les chômeurs, les droit commun, sollicités, se jettent dans la lutte de libération comme de robustes travailleurs. Ces désoeuvrés, ces déclassés vont, par le canal de l'action militante et décisive retrouver le chemin de la nation. Ils ne se réhabilitent pas vis-à-vis de la société coloniale ou de la morale du dominateur. Tout au contraire, ils assument leur incapacité à entrer dans la cité autrement que par la force de la grenade ou du revolver. Ces chômeurs et ces sous-hommes se réhabilitent vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de l'histoire. Les prostituées elles aussi, les bonnes à 2000 francs, les désespérées, tous ceux et toutes celles qui évoluent entre la folie et le suicide vont se rééquilibrer, vont se remettre en marche et participer de façon décisive à la grande procession de la nation réveillée.
***
Les partis nationalistes ne comprennent pas ce phénomène nouveau qui précipite leur désagrégation. L'irruption de l'insurrection dans les villes modifie la physionomie de la lutte. Alors que les troupes colonialistes étaient tout entières tournées vers les campagnes, les voici qui refluent précipitamment vers les [127] villes pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La répression disperse ses forces, le danger est partout présent. C'est le sol national, c'est l'ensemble de la colonie qui entrent en transes. Les groupes armés paysans assistent au desserrement de l'étreinte militaire. L'insurrection dans les villes est un ballon d'oxygène inespéré.
Les dirigeants de l'insurrection, qui voient le peuple enthousiaste et ardent porter des coups décisifs à la machine colonialiste, renforcent leur méfiance à l'égard de la politique traditionnelle. Chaque succès remporté légitime leur hostilité à l'égard de ce que désormais ils appellent le gargarisme, le verbalisme, la « blagologie », l'agitation stérile. Ils ressentent une haine de la « politique », de la démagogie. C'est pourquoi au début nous assistons à un véritable triomphe du culte de la spontanéité.
Les multiples jacqueries nées dans les campagnes attestent, partout où elles éclatent, de la présence ubiquitaire et généralement dense de la nation. Chaque colonisé en armes est un morceau de la nation désormais vivante. Ces jacqueries mettent en danger le régime colonial, mobilisent ses forces en les dispersant, menaçant à tout instant de les asphyxier. Elles obéissent à une doctrine simple : faites que la nation existe. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de résolutions, il n'y a pas de tendances. Le problème est clair : il faut que les étrangers partent. Constituons un front commun contre l'oppresseur et renforçons ce front par la lutte armée.
Tant que dure l'inquiétude du colonialisme, la cause nationale progresse et devient la cause de chacun. L'entreprise de libération se dessine et concerne déjà l'ensemble du pays. Dans cette période, le spontané est roi. L'initiative est localisée. Sur chaque piton, un gouvernement en miniature se constitue et assume le pouvoir. Dans les vallées et dans les forêts, dans la jungle et dans les villages, partout, on rencontre une autorité nationale. Chacun par son action fait exister la nation et s'engage à la faire localement triompher. Nous avons affaire à une stratégie de l'immédiateté totalitaire et radicale. Le but, le programme [128] de chaque groupe spontanément constitué est la libération locale. Si la nation est partout, alors elle est ici. Un pas de plus et elle n'est qu'ici. La tactique et la stratégie se confondent. L'art politique se transforme tout simplement en art militaire. Le militant politique, c'est le combattant. Faire la guerre et faire de la politique, c'est une seule et même chose.
Ce peuple déshérité, habitué à vivre dans le cercle étroite des luttes et des rivalités, va procéder dans une atmosphère solennelle à la toilette et à la purification du visage local de la nation. Dans une véritable extase collective, des familles ennemies décident de tout effacer, de tout oublier. Les réconciliations se multiplient. Les haines tenaces et enfouies sont réveillées pour être plus sûrement extirpées. L'assomption de la nation fait avancer la conscience. L'unité nationale est d'abord l'unité du groupe, la disparition des vieilles querelles et la liquidation définitive des réticences. Dans le même temps, la purification englobera les quelques autochtones qui, par leurs activités, par leur complicité avec l'occupant ont déshonoré le pays. Par contre, les traîtres et les vendus seront jugés et châtiés. Le peuple dans cette marche continue qu'il a entreprise légifère, se découvre et se veut souverain. Chaque point ainsi réveillé du sommeil colonial vit à une température insupportable. Une effusion permanente règne dans les villages, une générosité spectaculaire, une bonté désarmante, une volonté jamais démentie de mourir pour la « cause ». Tout cela évoque à la fois une confrérie, une église, une mystique. Aucun autochtone ne peut rester indifférent à ce nouveau rythme qui entraîne la nation. Des émissaires sont dépêchés aux tribus avoisinantes. Ils constituent le premier système de liaison de l'insurrection et apportent cadence et mouvement aux régions encore immobiles. Des tribus dont la rivalité opiniâtre est pourtant bien connue désarment, dans l'allégresse et dans les larmes, et se jurent assistance et soutien. Dans le coude à coude fraternel, dans la lutte armée, les hommes rejoignent leurs ennemis d'hier. Le cercle national s'agrandit et ce sont de nouvelles embuscades qui saluent l'entrée [129] en scène de nouvelles tribus. Chaque village se découvre agent absolu et relais. La solidarité intertribale, inter-villages, la solidarité nationale se déchiffrent d'abord dans la multiplication des coups portés à l'ennemi. Chaque nouveau groupe qui se constitue, chaque salve nouvelle qui éclate indiquent que chacun traque l'ennemi, que chacun fait face.
Cette solidarité va se manifester beaucoup plus clairement au cours de la seconde période qui se caractérise par le déclenchement de l'offensive ennemie. Les forces coloniales, après l'explosion, se regroupent, se réorganisent et inaugurent des méthodes de combat correspondant à la nature de l'insurrection. Cette offensive va remettre en question l'atmosphère euphorique et paradisiaque de la première période. L'ennemi déclenche l'attaque et concentre sur des points précis des forces importantes. Le groupe local est très rapidement débordé. Il l'est d'autant plus qu'il a tendance au début à accepter de front le combat. L'optimisme qui a régné dans la première période rend le groupe intrépide, voire inconscient. Le groupe qui s'est persuadé que son piton est la nation n'accepte pas de décrocher, ne supporte pas de battre en retraite. Les pertes sont nombreuses et le doute s'infiltre massivement dans les esprits. Le groupe subit l'assaut local comme une épreuve décisive. Il se comporte littéralement comme si le sort du pays se jouait ici et maintenant.
Mais, on l'a compris, cette impétuosité volontariste qui entend régler son sort tout de suite au système colonial est condamnée, en tant que doctrine de l'instantanéisme, à se nier. Le réalisme le plus quotidien, le plus pratique fait place aux effusions d'hier et se substitue à l'illusion d'éternité. La leçon des faits, les corps fauchés par la mitraille provoquent une réinterprétation globale des événements. Le simple instinct de survie commande une attitude plus mouvante, plus mobile. Cette modification dans la technique de combat est caractéristique des premiers mois de la guerre de libération du peuple angolais. On se souvient que, le 15 mars 1961, les paysans angolais se sont [130] lancés par groupe de deux ou trois mille contre les positions portugaises. Hommes, femmes et enfants, armés ou non armés, avec leur courage, leur enthousiasme, se sont rués en masses compactes et par vagues successives sur des régions où dominaient le colon, le soldat et le drapeau portugais. Des villages, des aérodromes ont été encerclés et ont subi des assauts multiples, mais aussi des milliers d'Angolais ont été fauchés par la mitraille colonialiste. Il n'a pas fallu longtemps aux chefs de l'insurrection angolaise pour comprendre qu'ils devaient trouver autre chose s'ils voulaient réellement libérer leur pays. Aussi, depuis quelques mois, le leader angolais Holden Roberto a-t-il réorganisé l'Armée nationale angolaise en tenant compte des différentes guerres de libération et en utilisant les techniques de guérilla.
Dans la guérilla en effet, la lutte n'est plus où l'on est mais où l'on va. Chaque combattant emporte la patrie en guerre entre ses orteils nus. L'armée de libération nationale n'est pas celle qui est aux prises une fois pour toutes avec l'ennemi mais celle qui va de village en village, qui se replie dans les forêts et qui trépigne de joie quand est aperçu dans la vallée le nuage de poussière soulevé par les colonnes adverses. Les tribus se mettent en branle, les groupes se déplacent, changeant de terrain. Les gens du nord font mouvement vers l'ouest, ceux de la plaine se hissent dans les montagnes. Aucune position stratégique n'est privilégiée. L'ennemi s'imagine nous poursuivre mais nous nous arrangeons toujours pour être sur ses arrières, le frappant au moment même où il nous croit anéantis. Désormais, c'est nous qui le poursuivons. Avec toute sa technique et sa puissance de feu, l'ennemi donne l'impression de patauger et de s'enliser. Nous chantons, nous chantons.
Entre-temps cependant, les dirigeants de l'insurrection comprennent qu'il faut éclairer les groupes, les instruire, les endoctriner, créer une armée, centraliser l'autorité. L'émiettement de la nation, qui manifestait la nation en armes, demande à être corrigé et dépassé. Les dirigeants qui avaient fui l'atmosphère de vaine politique des villes redécouvrent la politique, non plus [131] comme technique d'endormissement ou de mystification mais comme moyen unique d'intensifier la lutte et de préparer le peuple à la direction lucide du pays. Les dirigeants de l'insurrection s'aperçoivent que les jacqueries, même grandioses, demandent à être contrôlées et orientées. Les dirigeants sont amenés à nier le mouvement en tant que jacquerie, le transformant ainsi en guerre révolutionnaire. Ils découvrent que le succès de la lutte suppose la clarté des objectifs, la netteté de la méthodologie et surtout la connaissance par les masses de la dynamique temporelle de leurs efforts. On tient trois jours, à la rigueur trois mois, en utilisant la dose de ressentiment contenue dans les masses mais on ne triomphe pas dans une guerre nationale, on ne met pas en déroute la terrible machine de l'ennemi, on ne transforme pas les hommes si l'on oublie d'élever la conscience du combattant. Ni l'acharnement dans le courage, ni la beauté des slogans ne suffisent.
Le développement de la guerre de libération se charge d'ailleurs de porter un coup décisif à la foi des dirigeants. L'ennemi, en effet, modifie sa tactique. À la politique brutale de répression il allie opportunément les gestes spectaculaires de détente, les manoeuvres de division, « l'action psychologique ». Il tente çà et là et avec succès de redonner vie aux luttes tribales, utilisant les provocateurs, faisant ce que l'on appelle de la contre-subversion. Le colonialisme emploiera pour réaliser ses objectifs deux catégories d'autochtones. Et d'abord, les traditionnels collaborateurs, chefs, caïds, sorciers. Les masses paysannes plongées, nous l'avons vu, dans la répétition sans histoire d'une existence immobile continuent à vénérer les chefs religieux, les descendants des vieilles familles. La tribu, comme un seul homme, s'engage dans la voie qui lui est désignée par le chef traditionnel. À coups de prébendes, à prix d'or, le colonialisme s'attachera les services de ces hommes de confiance.
***
Le colonialisme va trouver également dans le lumpen-prolétariat une masse de manoeuvre considérable. Aussi tout mouvement de libération nationale doit-il apporter le maximum [132] d'attention à ce lumpen-prolétariat. Celui-ci répond toujours à l'appel de l'insurrection, mais si l'insurrection croit pouvoir se développer en l'ignorant, le lumpen-prolétariat, cette masse d'affamés et de déclassés, se jettera dans la lutte année, participera au conflit aux côtés, cette fois, de l'oppresseur. L'oppresseur, qui ne perd jamais une occasion de faire se bouffer les nègres entre eux, utilisera avec un rare bonheur l'inconscience et l'ignorance qui sont les tares du lumpen-prolétariat. Cette réserve humaine disponible, si elle n'est pas immédiatement organisée par l'insurrection, se retrouvera comme mercenaires aux cotés des troupes colonialistes. En Algérie, c'est le lumpen-prolétariat qui a fourni les harkis et les messalistes ; en Angola, c'est lui qui a donné ces ouvreurs de routes qui précèdent aujourd'hui les colonnes armées portugaises ; au Congo, on retrouve le lumpen-prolétariat dans les manifestations régionalistes du Kasaï et du Katanga, tandis qu'à Léopoldville il fut utilisé par les ennemis du Congo pour organiser des meetings « spontanés » anti-lumumbistes.
L'adversaire, qui analyse les forces de l'insurrection, qui étudie de mieux en mieux l'ennemi global que constitue le peuple colonisé, se rend compte de la faiblesse idéologique, de l'instabilité spirituelle de certaines couches de la population. L'adversaire découvre, latéralement à une avant-garde insurrectionnelle rigoureuse et bien structurée, une masse d'hommes dont l'engagement risque constamment d'être remis en question par une trop grande habitude de la misère physiologique, des humiliations et de l'irresponsabilité. L'adversaire utilisera cette masse, quitte à payer le prix fort. Il créera du spontané à coups de baïonnettes ou de châtiments exemplaires. Les dollars et les francs belges se déversent sur le Congo tandis qu'à Madagascar se multiplient les exactions anti-Hova et qu'en Algérie des recrues, authentiques otages, sont enrôlées dans les forces françaises. À le lettre, le dirigeant de l'insurrection voit chavirer la nation. Des tribus entières se constituent en harkis et, dotées d'armes modernes, prennent le sentier de la guerre et envahissent la tribu rivale, étiquetée pour la circonstance nationaliste. [133]
L'unanimité dans le combat, si féconde et si grandiose aux premières heures de l'insurrection, s'altère. L'unité nationale s'effrite, l'insurrection est à un tournant décisif. La politisation des masses est alors reconnue comme nécessité historique.
Ce volontarisme spectaculaire qui entendait mener d'un seul coup le peuple colonisé à la souveraineté absolue, cette certitude que l'on avait de charrier avec soi à la même allure et sous le même éclairage tous les morceaux de la nation, cette force qui fondait l'espoir se révèlent être à l'expérience une très grande faiblesse. Tant qu'il s'imaginait pouvoir passer sans transition de l'état de colonisé à l'état de citoyen souverain d'une nation indépendante, tant qu'il se prenait au mirage de l'immédiateté de ses muscles, le colonisé ne réalisait pas de véritables progrès dans la voie de la connaissance. Sa conscience restait rudimentaire. Le colonisé s'engage dans la lutte avec passion, nous l'avons vu, surtout si cette lutte est armée. Les paysans se sont lancés dans l'insurrection avec d'autant plus d'enthousiasme qu'ils n'avaient point cessé de se crisper sur un mode de vie pratiquement anticolonial. De toute éternité et à la suite de ruses multiples, de rééquilibrations évoquant les prouesses du prestidigitateur, les paysans avaient relativement préservé leur subjectivité de l'imposition coloniale. Ils en arrivaient à croire que le colonialisme n'était pas vraiment vainqueur. L'orgueil du paysan, sa réticence à descendre dans les villes, à côtoyer le monde édifié par l'étranger, ses perpétuels mouvements de recul à l'approche des représentants de l'administration coloniale ne cessaient de signifier qu'il opposait à la dichotomie du colon sa propre dichotomie.
Le racisme antiraciste, la volonté de défendre sa peau qui caractérise la réponse du colonisé à l'oppression coloniale représentent évidemment des raisons suffisantes pour s'engager dans la lutte. Mais on ne soutient pas une guerre, on ne subit pas une répression énorme, on n'assiste pas à la disparition de toute sa famille pour faire triompher la haine ou le racisme. Le racisme, la haine, le ressentiment, « le désir légitime de vengeance » [134] ne peuvent alimenter une guerre de libération. Ces éclairs dans la conscience qui jettent le corps dans des chemins tumultueux, qui le lancent dans un onirisme quasi pathologique où la face de l'autre m'invite au vertige, où mon sang appelle le sang de l'autre, où ma mort par simple inertie appelle la mort de l'autre, cette grande passion des premières heures se disloque si elle entend se nourrir de sa propre substance. Il est vrai que les interminables exactions des forces colonialistes réintroduisent les éléments émotionnels dans la lutte, donnent au militant de nouveaux motifs de haine, de nouvelles raisons de partir à la recherche du « colon à abattre ». Mais le dirigeant se rend compte jour après jour que la haine ne saurait constituer un programme. On ne peut, sinon par perversion, faire confiance à l'adversaire qui évidemment se débrouille toujours pour multiplier les crimes, approfondir le « fossé », rejetant ainsi le peuple global du côté de l'insurrection. En tout état de cause, l'adversaire, nous l'avons signalé, tâche de gagner la sympathie de certains groupes de la population, de certaines régions, de certains chefs. Au cours de la lutte, des consignes sont données aux colons et aux forces de police. Le comportement se nuance, « s'humanise ». On ira même jusqu'à introduire dans les rapports colon-colonisé des locutions telles que Monsieur ou Madame. On multipliera les politesses, les prévenances. Concrètement, le colonisé a l'impression d'assister à un changement.
Le colonisé qui n'a pas pris seulement les armes parce qu'il mourait de faim et qu'il assistait à la désagrégation de sa société, mais aussi parce que le colon le considérait comme une bête, le traitait comme une bête, se montre très sensible à ces mesures. La haine est désamorcée par ces trouvailles psychologiques. Les technologues et les sociologues éclairent les manoeuvres colonialistes et multiplient les études sur les « complexes » : complexe de frustration, complexe belliqueux, complexe de colonisabilité. On promeut l'indigène, on essaie de le désarmer par la psychologie et, naturellement, quelques pièces de monnaie. [135] Ces mesures misérables, ces réparations de façade, d'ailleurs savamment dosées, arrivent à remporter certains succès.
La faim du colonisé est telle, sa faim de n'importe quoi qui l'humanise — même au rabais — est à ce point incoercible que ces aumônes parviennent localement à l'ébranler. Sa conscience est d'une telle précarité, d'une telle opacité, qu'elle s'émeut à la moindre étincelle. La grande soif de lumière indifférenciée du début est menacée à tout instant par la mystification. Les exigences violentes et globales qui rayaient le ciel se replient, se font modestes. Le loup impétueux qui voulait tout dévorer, la bourrasque qui voulait effectuer une authentique révolution menace, si la lutte dure, et elle dure, de devenir méconnaissable. Le colonisé risque à tout instant de se laisser désarmer par n'importe quelle concession.
Les dirigeants de l'insurrection découvrent cette instabilité du colonisé avec effroi. D'abord désorientés, ils comprennent, par ce nouveau biais, la nécessité d'expliquer et d'opérer le désenlisement radical de la conscience. Car la guerre dure, l'ennemi s'organise, se renforce, devine la stratégie du colonisé. La lutte de libération nationale ne consiste pas à franchir un espace d'une unique foulée. L'épopée est quotidienne, difficile, et les souffrances que l'on endure dépassent toutes celles de la période coloniale. En bas, dans les villes, il paraît que les colons ont changé. Les nôtres sont plus heureux. On les respecte. Les jours succèdent aux jours et il ne faut pas que le colonisé engagé dans la lutte, le peuple qui doit continuer à donner son appui basculent. Ils ne doivent pas s'imaginer que le but est atteint. Ils ne doivent pas, quand on leur précise les objectifs réels de la lutte, s'imaginer que cela n'est pas possible. Encore une fois, il faut expliquer, il faut que le peuple voie où il va, comment y aller. La guerre n'est pas une bataille mais une succession de combats locaux dont, à la vérité, aucun n'est décisif.
Il y a donc nécessité de ménager ses forces, de ne pas les jeter d'un seul coup dans la balance. Les réserves du colonialisme sont plus riches, plus importantes que celles du colonisé. La guerre dure. L'adversaire se défend. La grande explication [136] n'est ni pour aujourd'hui, ni pour demain. En fait, elle a commencé dès le premier jour et elle ne prendra pas fin parce qu'il n'y aura plus d'adversaire, mais tout simplement parce que ce dernier, pour de multiples raisons, se rendra compte qu'il y va de son intérêt de terminer cette lutte et de reconnaître la souveraineté du peuple colonisé. Les objectifs de la lutte ne doivent pas rester dans l'indifférenciation des premiers jours. Si l'on n'y prend garde on risque à tout instant de voir le peuple se demander, à l'occasion de la moindre concession faite par l'ennemi, les raisons de la prolongation de la guerre. On s'est à ce point habitué au mépris de l'occupant, à sa volonté affirmée de maintenir coûte que coûte son oppression que toute initiative d'allure généreuse, toute bonne disposition manifestée est saluée avec étonnement et allégresse. Le colonisé a alors tendance à chanter. Il faut multiplier les explications et faire comprendre au militant que les concessions de l'adversaire ne doivent pas l'aveugler. Ces concessions, qui ne sont rien d'autre que des concessions, ne portent pas sur l'essentiel et, dans la perspective du colonisé, on peut affirmer qu'une concession ne porte pas sur l'essentiel quand elle ne touche pas le régime colonial dans ce qu'il a d'essentiel.
Précisément, les formes brutales de présence de l'occupant peuvent parfaitement disparaître. En fait, cette disparition spectaculaire se révèle être un allégement des dépenses de l'occupant et une mesure positive contre l'éparpillement des forces. Mais cette disparition sera monnayée au prix fort. Très exactement au prix d'un encadrement plus coercitif du destin du pays. Des exemples historiques seront évoqués à l'aide desquels le peuple pourra se convaincre que la mascarade de la concession, que l'application du principe de la concession à tout prix se sont soldées pour certains pays par un asservissement plus discret mais plus total. Le peuple, l'ensemble des militants devront connaître cette loi historique qui stipule que certaines concessions sont, en fait, des carcans. Quand le travail de clarification n'a pas été fait, on est étonné de la facilité avec laquelle les dirigeants de certains partis politiques s'engagent dans des compromissions [137] sans nom avec l'ancien colonisateur. Le colonisé doit se persuader que le colonialisme ne lui fait aucun don. Ce que le colonisé obtient par la lutte politique ou armée n'est pas le résultat de la bonne volonté ou du bon coeur du colon mais traduit son impossibilité à différer les concessions. Davantage, le colonisé doit savoir que ces concessions, ce n'est pas le colonialisme qui les fait, mais lui. Quand le gouvernement britannique décide d'octroyer à la population africaine quelques sièges de plus à l'Assemblée du Kenya, il faut beaucoup d'impudeur ou d'inconscience pour prétendre que le gouvernement britannique a fait des concessions. Ne voit-on pas que c'est le peuple kenyan qui fait des concessions ? Il faut que les peuples colonisés, il faut que les peuples qui ont été dépouillés perdent l'attitude mentale qui jusqu'à présent les a caractérisés. À la rigueur le colonisé peut accepter un compromis avec le colonialisme mais jamais une compromission.
***
Toutes ces explications, ces éclairages successifs de la conscience, ce cheminement dans la voie de la connaissance de l'histoire des sociétés ne sont possibles que dans le cadre d'une organisation, d'un encadrement du peuple. Cette organisation est mise sur pied par l'utilisation des éléments révolutionnaires venus des villes au début de l'insurrection et de ceux qui rejoignent les campagnes au fur et à mesure du développement de la lutte. C'est ce noyau qui constitue l'organisme politique embryonnaire de l'insurrection. Mais, de leur côté, les paysans qui élaborent leurs connaissances au contact de l'expérience se révéleront aptes à diriger la lutte populaire. Il s'installe un courant d'édification et d'enrichissement réciproque entre la nation sur le pied de guerre et ses dirigeants. Les institutions traditionnelles sont renforcées, approfondies et quelquefois littéralement transformées. Le tribunal des conflits, les djemaas, les assemblées de village se transforment en tribunal révolutionnaire, en comité politico-militaire. Dans chaque groupe de combat, dans chaque village, surgissent des légions de commissaires politiques. Le peuple qui commence à buter sur des îlots d'incompréhension [138] sera éclairé par ces commissaires politiques. C'est ainsi que ces derniers ne craindront pas d'aborder les problèmes qui, s'ils n'étaient pas explicités, contribueraient à désorienter le peuple. Le militant en armes est, en effet, irrité de voir que beaucoup d'indigènes continuent à mener leur vie dans les cités comme s'ils étaient étrangers à ce qui se passe dans les montagnes, comme s'ils ignoraient que le mouvement essentiel est commencé. Le silence des villes, la continuation du train-train quotidien donnent au paysan l'impression amère que tout un secteur de la nation se contente de compter les points. Ces constatations révoltent les paysans et renforcent leur tendance à mépriser et à condamner globalement les urbains. Le commissaire politique devra les amener à nuancer cette position par la prise de conscience que certaines fractions de la population possèdent des intérêts particuliers qui ne recouvrent pas toujours l'intérêt national. Le peuple comprend alors que l'indépendance nationale met au jour des réalités multiples qui, quelquefois, sont divergentes et antagonistes. L'explication, à ce moment précis de la lutte, est décisive car elle fait passer le peuple du nationalisme global et indifférencié à une conscience sociale et économique. Le peuple, qui au début de la lutte avait adopté le manichéisme primitif du colon : les Blancs et les Noirs, les Arabes et les Roumis, s'aperçoit en cours de route qu'il arrive à des Noirs d'être plus blancs que les Blancs et que l'éventualité d'un drapeau national, la possibilité d'une nation indépendante n'entraînent pas automatiquement certaines couches de la population à renoncer à leurs privilèges ou à leurs intérêts. Le peuple s'aperçoit que des indigènes comme lui ne perdent pas le nord mais bien au contraire, semblent profiter de la guerre pour renforcer leur situation matérielle et leur puissance naissante. Les indigènes trafiquent et réalisent de véritables profits de guerre aux dépens du peuple qui, comme toujours, se sacrifie sans restrictions et arrose de son sang le sol national. Le militant qui fait face, avec des moyens rudimentaires, à la machine de guerre colonialiste se rend compte que dans le même temps où il démolit l'oppression coloniale il contribue par la bande à construire [139] un autre appareil d'exploitation.
Cette découverte est désagréable, pénible et révoltante. Tout était simple pourtant, d'un côté les mauvais, de l'autre les bons. À la clarté idyllique et irréelle du début se substitue une pénombre qui disloque la conscience. Le peuple découvre que le phénomène inique de l'exploitation peut présenter une apparence noire ou arabe. Il crie à la trahison mais il faut corriger ce cri. La trahison n'est pas nationale, c'est une trahison sociale, il faut apprendre au peuple à crier au voleur. Dans son cheminement laborieux vers la connaissance rationnelle le peuple devra également abandonner le simplisme qui caractérisait sa perception du dominateur. L'espèce se morcelle devant ses yeux. Autour de lui il constate que certains colons ne participent pas à l'hystérie criminelle, qu'ils se différencient de l'espèce. Ces hommes, qu'on rejetait indifféremment dans le bloc monolithique de la présence étrangère, condamnent la guerre coloniale. Le scandale éclate vraiment quand des prototypes de cette espèce passent de l'autre côté, se font nègres ou arabes et acceptent les souffrances, la torture, la mort.
Ces exemples désarment la haine globale que le colonisé ressentait à l'égard du peuplement étranger. Le colonisé entoure ces quelques hommes d'une affection chaleureuse et a tendance, par une sorte de surenchère affective, à leur faire confiance de façon absolue. Dans la métropole, perçue comme marâtre implacable et sanguinaire, des voix nombreuses et quelquefois illustres prennent position, condamnent sans réserve la politique du guerre de leur gouvernement et conseillent de tenir compte enfin de la volonté nationale du peuple colonisé. Des soldats désertent les rangs colonialistes, d'autres refusent explicitement de se battre contre la liberté du peuple, vont en prison, souffrent au nom du droit de ce peuple à l'indépendance et à la gestion de ses propres affaires.
Le colon n'est plus simplement l'homme à abattre. Les membres de la masse colonialiste se révèlent être plus près, infiniment plus près de la lutte nationaliste que certains fils de la [140] nation. Le niveau racial et raciste est dépassé dans les deux sens. On ne délivre plus un brevet d'authenticité à tout nègre ou à tout musulman. On ne cherche plus son fusil ou sa machette à l'apparition de n'importe quel colon. La conscience débouche laborieusement sur des vérités partielles, limitées, instables. Tout cela, on s'en doute, est fort difficile. La tâche de rendre le peuple adulte sera facilitée à la fois par la rigueur de l'organisation et par le niveau idéologique de ses dirigeants. La puissance du niveau idéologique s'élabore et se renforce au fur et à mesure du déroulement de la lutte, des manoeuvres de l'adversaire, des victoires et des revers. La direction révèle sa force et son autorité en dénonçant les erreurs, en profitant de chaque retour en arrière de la conscience pour tirer la leçon, pour assurer de nouvelles conditions de progrès. Chaque reflux local sera utilisé pour reprendre la question à l'échelle de tous les villages, de tous les réseaux. L'insurrection se prouve à elle-même sa rationalité, exprime sa maturité chaque fois qu'à partir d'un cas elle fait avancer la conscience du peuple. En dépit de l'entourage qui quelquefois incline à penser que les nuances constituent des dangers et introduisent des failles dans le bloc populaire, la direction demeure ferme sur les principes dégagés dans la lutte nationale et dans la lutte générale que l'homme mène pour sa libération. Il y a une brutalité et un mépris des subtilités et des cas individuels qui sont typiquement révolutionnaires mais il existe une autre sorte de brutalité ressemblant étonnamment à la première et qui sont typiquement contre-révolutionnaires, aventurière et anarchiste.
Cette brutalité pure, totale, si elle n'est pas immédiatement combattue, entraîne immanquablement la défaite du mouvement au bout de quelques semaines.
Le militant nationaliste qui avait fui la ville, ulcéré par les manoeuvres démagogiques et réformistes des dirigeants, déçu par la « politique », découvre dans la praxis concrète une nouvelle politique qui ne ressemble plus du tout à l'ancienne. Cette politique est une politique de responsables, de dirigeants insérés dans l'histoire qui assument avec leurs muscles et avec leurs [141] cerveaux la direction de la lutte de libération. Cette politique et nationale, révolutionnaire, sociale. Cette nouvelle réalité que le colonisé va maintenant connaître n'existe que par l'action. C'est la lutte qui, en faisant exploser l'ancienne réalité coloniale, révèle des facettes inconnues, fait surgir des significations nouvelles et met le doigt sur les contradictions camouflées par cette réalité.
Le peuple qui lutte, le peuple qui, grâce à la lutte, dispose cette nouvelle réalité et la connaît, avance, libéré du colonialisme, prévenu par avance contre toutes les tentatives de mystification, contre tous les hymnes à la nation. Seule la violence exercée par le peuple, violence organisée et éclairée par la direction, permet aux masses de déchiffrer la réalité sociale, lui en donne la clef. Sans cette lutte, sans cette connaissance dans la praxis, il n'y a plus que carnaval et flonflons. Un minimum de réadaptation, quelques réformes au sommet, un drapeau et, tout en bas, la masse indivise, toujours « moyenâgeuse », qui continue son mouvement perpétuel.